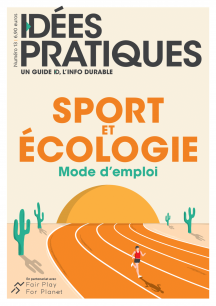Le climat change à une vitesse jusque-là jamais éprouvée, déréglé par les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère au quotidien. Il est urgent d'agir pour atténuer cette crise et s'adapter aux conséquences présentes et à venir, rappellent les scientifiques. Le climatologue Philippe Bousquet, directeur du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, professeur et chercheur spécialiste des cycles du carbone, revient sur les principaux mécanismes et conséquences et sur les actions que peuvent mener les citoyens.
Depuis des décennies, les climatologues sonnent l’alerte et rappellent l'urgence de lutter contre le changement climatique. Pourtant, beaucoup de citoyens ignorent encore ce qu'il en est. Comment le définiriez-vous ?
Le changement climatique actuel est à la fois rapide et causé par des activités humaines. C'est sa fulgurance – des changements importants sont observables sur quelques décennies – et son origine anthropique qui le caractérisent.
L’origine humaine de la crise climatique que nous vivons, fait consensus chez les climatologues depuis des années. Comment l’humanité influe-t-elle sur le climat ?
Les humains émettent des gaz à effet de serre en grandes quantités dans l'atmosphère. Ces émissions sont principalement liées, pour le CO2, aux activités de combustion d'énergies fossiles [le pétrole, le gaz et le charbon que nous utilisons pour nous déplacer, nous chauffer, fabriquer des objets, etc. ndlr]. Le méthane, lui, est émis par des fuites [il est notamment présent dans les océans ou sous le pergélisol, le sol gelé, ndlr] et des processus microbiens, par exemple les zones humides et l'élevage. Quant au protoxyde d'azote, il est en grande partie lié aux activités agricoles.
Le réchauffement climatique cause des perturbations météorologiques avec des événements extrêmes, devenant probablement plus fréquents et plus intenses.
Cette concentration plus importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère contribue à augmenter les températures, perturbe sa chimie et le cycle du carbone. Le système Terre est un système complexe en interactions permanentes. L'atmosphère est notamment en interaction avec les océans, la végétation et les sols, qui stockent l’équivalent de la moitié des émissions de CO2 anthropiques, ralentissant le changement climatique.
Ces puits de carbone sont sensibles au changement climatique et pourraient diminuer si la perturbation devenait trop forte. Aujourd'hui, les scientifiques sont capables de quantifier précisément le taux des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et leur évolution. Le Giec [Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat] a conclu en 2014 que 95 % du changement climatique est d'origine anthropique, causé par les émissions de gaz à effet de serre [interview réalisée en juin avant la publication du dernier rapport du groupe I du Giec, qui affirme que l'origine anthropique est indiscutable, ndlr].
Contrairement à une idée reçue, le changement climatique ne correspond pas juste à une augmentation moyenne des températures. Quelles sont les conséquences attendues du changement climatique à court et long terme ?
Effectivement, on a tendance à restreindre le changement climatique à la hausse moyenne des températures, de l’ordre de 1,5°C pour les continents. Cette hausse est toutefois variable d'une région à l'autre. On assiste également à un changement de la répartition des précipitations, plus difficile à évaluer, avec des zones s’asséchant, par exemple le bassin méditerranéen, et des zones plus humides. Il y a aussi une répercussion sur la montée des eaux. La raison ? La fonte des glaciers et des calottes glaciaires, mais aussi l’expansion de l’eau des océans, plus chaude. Ces conséquences, directes, sont inéluctables.
Ensuite, le réchauffement climatique cause des perturbations météorologiques avec des événements extrêmes, devenant probablement plus fréquents et plus intenses. On peut citer les ouragans, les précipitations intenses comme les épisodes cévenols, les sécheresses, les vagues de chaleur ou de froid, qui peuvent s'avérer très perturbants pour les sociétés et les écosystèmes. Regardez la situation, typique, que nous avons connue au printemps. En soi, il n'est pas anormal d'avoir du gel en avril. Mais il y a eu un enchaînement, entre une vague de chaud, en mars, qui a amené un bourgeonnement précoce des plantes, puis une vague de froid en avril, qui a détruit les fleurs et donc une partie des futures récoltes. Ces alternances risquent de se produire de plus en plus à l'avenir. La fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes comportent toutefois leur lot d'incertitudes et doivent continuer à être étudiées.
Toutes ces conséquences perturbent la vie des hommes mais ont aussi des effets sur son environnement, sur les écosystèmes, sur les espèces animales et végétales. Dans un premier temps, le changement climatique peut, par exemple, être favorable à la croissance de la végétation à nos latitudes, mais à moyen terme, avec une fréquence accrue des sécheresses et des vagues de chaleur notamment, aura au contraire des effets négatifs. Certaines espèces ont également beaucoup de difficultés à s'adapter à une hausse de quelques dixièmes de degrés [Par exemple, selon un rapport du Giec, une hausse des températures de 1,5°C entraînerait la disparition de 70 % des coraux contre 99 % en cas de hausse de 2°C, ndlr].
Si nous continuons à brûler des énergies fossiles en grande quantité comme nous le faisons ou si nous adoptons un mode de vie très sobre, très vertueux, l'intensité du changement climatique sera très différente, tout comme ses impacts.
Le changement climatique entraîne des hausses des moyennes, de la variabilité mais aussi des incertitudes. Quelles sont-elles ?
Cela dépend des horizons. A court terme, les incertitudes dépendent surtout des modèles climatiques, indispensables pour se projeter dans l’avenir climatique. Les modélisations que nous faisons sont des représentations qui essaient de coller le plus possible à la réalité du système Terre et à ses composantes, sans toutefois être la réalité. Car il faut faire des hypothèses qui varient selon les modèles. Par exemple, la représentation des nuages, de la végétation, ou des calottes de glace. Ces choix induisent des incertitudes. Grâce aux connaissances accumulées sur les climats passés, aux données collectées dans le passé et le présent, on améliore progressivement les modèles de climat, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Les climatologues peuvent observer les évolutions anormales et établir des probabilités sur l'existence d'un phénomène.
A long terme, typiquement la fin de ce siècle, les incertitudes dépendent essentiellement des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Si nous continuons à brûler des énergies fossiles en grande quantité comme nous le faisons ou si nous adoptons un mode de vie très sobre, très vertueux, l'intensité du changement climatique sera très différente, tout comme ses impacts. Les scénarios se ressemblent à court terme mais ensuite, au fil des décennies, ils divergent.
Le Giec va finaliser en 2022 son sixième rapport, très attendu, sur les causes et conséquences du changement climatique. Vous étiez un des auteurs des deux derniers rapports. Quel est le rôle du Giec et comment travaille-t-il ?
Le Giec est un groupe de scientifiques, chargé depuis 1988 de faire régulièrement, tous les 5 à 7 ans, un état des connaissances scientifiques sur le changement climatique, à travers des rapports destinés aux Etats. Il ne fait pas de recherche mais se base sur des articles scientifiques, publiés dans des revues à comité de lecture, c'est-à-dire relus par les pairs, pour établir leurs conclusions.
Cet article est extrait de notre dossier spécial : "Climat : tout comprendre aux enjeux et à la mobilisation citoyenne". A découvrir ici !
Trois groupes d'auteurs sont désignés pour écrire leur rapport traitant respectivement de l’état de l’art scientifique, des impacts et de l’adaptation, et de l’atténuation du changement climatique. Pour chaque chapitre d’un rapport, les auteurs rédigent un passage en fonction de leur domaine de compétence. Puis, le texte est soumis à une relecture de la communauté scientifique qui envoie des milliers de commentaires. Les auteurs du Giec y répondent, modifient certains passages et aboutissent à une seconde version. Elle-même est soumise au même processus de relecture. A la fin, les auteurs arrivent à une version finale de plus de mille pages, par exemple, pour le rapport scientifique. Le groupe d'experts publie à la fois des rapports d'évaluation et des rapports spéciaux [exemples récents sur les océans ou sur les conséquences d'une hausse des températures de 1,5°C, ndlr].
Autre point important, les rapports du Giec constituent la base pour écrire un résumé pour décideurs, d'une cinquantaine de pages, négocié entre les auteurs du Giec et les représentants des gouvernements en réunion plénière. Les mots sont minutieusement choisis, débattus, avant que le résumé ne soit voté. Au final, l'ensemble du processus donne une légitimité au Giec et permet une adhésion des politiques aux résultats des scientifiques.
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez essayer de faire du covoiturage ou d'aller au travail à vélo, changer moins souvent/réparer les appareils quotidiens.
Le Giec et l'Ipbes [Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques] ont sorti récemment un travail commun pour expliquer que les crises climatiques et de la biodiversité se renforçaient mutuellement et devaient être traitées conjointement. Cela a-t-il des conséquences sur le travail des climatologues ?
Certains climatologues travaillent à l'interface avec les problématiques de biodiversité, sur les modèles de végétation ou les modèles agricoles ou forestiers par exemple. Les collègues spécialistes de la biodiversité peuvent utiliser, reprendre nos scénarios, et nous, nous lisons davantage leurs travaux. Nous commençons à collaborer, à avoir des projets communs. Ce sont les prémices.
Ce qu'il est important de dire, c'est que pour la remédiation, il faut avoir une vision transverse des questions posées pour éviter les dommages collatéraux. Prenons l'exemple du reboisement [les forêts, des puits de carbone, permettent de stocker le carbone émis dans l'atmosphère, ndlr]. Si l'on opte pour de la monoculture, cela ne sera pas sans conséquences pour la biodiversité. Il est donc important de considérer les enjeux climatiques avec une approche intégrée, multifactorielle.
Le changement climatique que nous vivons est généralisé, rapide et il s'intensifie : l'ampleur des changements est sans précédent, conclut le dernier rapport du groupe I du GIEC, publié le 9 août 2021. Ce document de 3949 pages, écrit par 234 auteurs, dresse un état des lieux des connaissances scientifiques et de la compréhension physique du climat, en se basant sur plus de 14 000 publications scientifiques. Huit ans après la dernière synthèse, il atteste que les activités humaines sont indiscutablement à l'origine de la crise climatique et que ce changement affecte déjà chaque région de la planète, de multiples façons. Le seuil de température de 1,5°C sera, quant à lui, très probablement atteint ou dépassé d'ici 2040. Autre conclusion : certains changements sont irréversibles mais d'autres peuvent être ralentis ou arrêtés si nous agissons. Pour cela, il faut réduire drastiquement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre. Les rapports des groupes 2 et 3 du Giec, respectivement sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité et sur les solutions globales pour atténuer le changement climatique, seront publiés au début de l'année 2022 et le sixième rapport d'évaluation devrait être publié dans sa totalité en septembre 2022.
L’urgence climatique demande des changements politiques et économiques majeurs. Comment les citoyens, à leur échelle, peuvent-ils prendre part à la transition ?
Avec l'idée du facteur 2 [réduire ses émissions de gaz à effet de serre par deux, ndlr], qui est un minimum, si on essaie de l'appliquer à soi-même, c'est déjà un bon départ. De nombreuses actions peuvent être menées, mais il est d'abord nécessaire, pour chacun, d'identifier ses gros postes d'émissions – les achats, les transports, etc. On peut le faire facilement aujourd’hui en faisant son bilan carbone, avec de nombreux outils sur Internet.
Puis, vient le temps des applications concrètes pour réduire son empreinte carbone. Les chercheurs, par exemple, peuvent essayer de diminuer leurs trajets professionnels en avion. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez essayer de faire du covoiturage ou d'aller au travail à vélo, changer moins souvent/réparer les appareils quotidiens (électroménager, informatique, etc.). L'idée est d'identifier les comportements écoresponsables que vous pouvez adopter dans la vie de tous les jours en commençant par les plus grosses causes d’émission.
Nous sommes tous réfractaires au changement, mais il est important de souligner qu'on peut, par ce biais, gagner en qualité de vie. Par exemple, en prenant le train plutôt que l'avion pour les déplacements professionnels, on peut éviter le temps de trajet jusqu'à l'aéroport, les contrôles, et passer son voyage, assis, à travailler calmement. Le covoiturage peut générer du lien social et diminuer le stress des trajets domicile-travail... En d'autres termes, il est important de positiver la transition à initier de façon urgente dans les années à venir !
Vous avez apprécié cette information ? Abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici !
Pour aller plus loin et agir à votre échelle, découvrez notre guide pratiques "365 jours pour faire sa transition Made in France"
Au sommaire : enjeux, analyses, interview, quiz, conseils et astuces... 68 pages de solutions pour passer au 100% Made in France.

Pour en savoir plus et commander votre guide, c'est par ici.
#TousActeurs