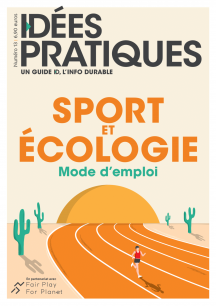Les marches citoyennes
En France, l'été 2018, marqué par les catastrophes climatiques (mégafeux, records de température, inondations), constitue un tournant dans la mobilisation pour le climat. La démission historique du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, amène un élan de la société civile, qui organise dans la foulée la première marche pour le climat. Celle-ci réunit des dizaines de milliers de citoyens qui, partout en France, à l'aide de pancartes et de slogans rappellent l'urgence à agir et interpellent les dirigeants. Cette marche du 8 septembre 2018 est suivie de nombreuses autres.
La même année, la mobilisation citoyenne se structure un peu partout dans le monde. En Suède, la militante Greta Thunberg, alors inconnue, lance la première grève scolaire pour le climat. Ses discours, percutants, basés sur la science, marquent les esprits et elle devient l'une des voix des citoyens dans les négociations internationales.
Au fur et à mesure, le mouvement de la jeunesse Fridays for future [les vendredis pour le futur] gagne les cinq continents. Une marche étudiante mondiale du 27 septembre 2019 se tient quelques jours après le sommet Action climat de l'ONU, à New York. Elle réunit près de deux millions de participants, selon The Guardian. En 2020, la crise sanitaire stoppe ces mobilisations même si les grèves scolaires pour le climat continuent, chaque vendredi, sur les réseaux sociaux.
Les contentieux climatiques
"Depuis une dizaine d'années, les citoyens, par le truchement de la société civile et des ONG, ont pris la mesure de leur force sur les questions climat. L'une des voies qu'ils choisissent est d'utiliser le droit comme une arme, comme un ultime levier pour avertir les politiques de leurs carences", indique Christel Cournil, professeure de droit public à Sciences Po Toulouse et membre du Conseil d'administration de l'association Notre Affaire à tous.
Cet article est extrait de notre dossier spécial : "Climat : tout comprendre aux enjeux et à la mobilisation citoyenne". A découvrir ici !
Apparus aux États-Unis dans les années 2000, les contentieux climatiques ont connu un tournant en Europe, en 2015, avec une décision historique de la justice néerlandaise, qui contraint les Pays-Bas à renforcer leur politique climatique. A l'origine de l'affaire, la fondation Urgenda et plus de 800 citoyens. Pour la première fois, il n'est pas question d'indemnisation pour des dommages résultant d'une politique climatique insuffisante mais d'injonction à ce que l'Etat fasse "plus et mieux" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
"Le juge déclare la question légitime et, contre toute attente, utilise des arguments de droit de l'Homme pour construire une obligation de diligence climatique", poursuit Christel Cournil. Peu après première décision en 2015, qui sera confirmée ensuite en appel et en cassation, "l'effet politico-juridique induit est immédiat : prise de conscience, débat parlementaire, proposition de loi sur la neutralité carbone, mouvement de la société civile", énumère la juriste.
L'affaire Urgenda inspire en France un collectif de juristes, qui monte "Notre Affaire à tous" pour porter le recours. Avec Greenpeace, Oxfam, et la FNH, l'association lance l'Affaire du siècle pour assigner devant la justice l’État français pour inaction climatique. Une pétition lancée fin 2018 pour associer les citoyens, recueille, en moins d'une semaine, deux millions de signatures. Un record. Le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît dans son jugement une faute de l'Etat. Quelques mois plus tard, le 1er juillet, le Conseil d’Etat donne neuf mois à l’Etat pour prendre "toutes les mesures utiles" pour atteindre l'objectif de baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une décision sans précédent.
Le 14 octobre dernier, le verdict tombe. La justice ordonne à L'Etat de "réparer" ses engagements non tenus de baisse des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique, et laisse le choix des mesures à prendre à "la libre appréciation du gouvernement". Un échéancier est toutefois fixé prévoyant que "cette réparation soit effective au 31 décembre 2022, au plus tard". Le jugement rejette toutefois la demande des ONG d'une astreinte financière de 78 millions par semestre de retard.
En Europe, les contentieux climatiques se multiplient. Les citoyens, épaulés par les associations, n'hésitent plus à assigner en justice les Etats, les multinationales notamment pétrolières (Total et Shell), ou encore à attaquer des projets locaux (extension d'aéroport, exploitation de mine, etc.). Mi-juin, les militants Camille Etienne et Cyril Dion et l'eurodéputé socialiste Pierre Larrouturou ont déposé une plainte devant la cour de Justice de la République pour inaction climatique contre le premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon et le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Depuis, le 19 octobre, la plainte accusant Castex et quatre ministres d’inaction contre le changement climatique a été déclarée irrecevable.
"Les citoyens ont été largement exclus des négociations internationales. Depuis qu'il y a une urgence climatique avérée, démontrée par les rapports du Giec, la société civile s'est conscientisée et est allée chercher ce recours au juge participant ainsi à reconfigurer la gouvernance climatique par le bas", rappelle Christel Cournil. Le juge est désormais un acteur à part entière dans la gouvernance climat.
À noter que...
L'engagement climatique des citoyens se traduit parfois jusque dans la fabrique de la loi. A la suite du mouvement des gilets jaunes et du grand débat, le président de la République lance la Convention citoyenne pour le climat.
150 citoyens tirés au sort, issu de toute la France, de tous âges, étudiants, actifs, chômeurs, retraités, planchent ensemble pour trouver des solutions pour diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en France, d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Si les 150 déplorent dans leur majorité que le projet de loi issu de leur travaux ne soit pas à la hauteur, ils continuent pour certains à s'impliquer autour des enjeux climatiques.
La désobéissance civile
Si certains choisissent de saisir les tribunaux pour se faire entendre, d'autres assument de mener des actions contre la loi pour rendre visible la bataille contre le changement climatique. Au XXe siècle, la désobéissance civile a notamment permis aux Indiens, menés par Gandhi lors de la Marche du sel en 1930, de s'affranchir de la domination britannique sur l'exploitation du sel. Ce mode d'action pacifique a également été utilisé par Martin Luther King et les défenseurs des droits civiques des Noirs aux États-Unis, dans les années 1950, notamment via le boycott des bus à Montgomery (Alabama).
Depuis la COP 21 en 2015, les actions de désobéissance climatique sont plus nombreuses et plus visibles. En Allemagne, par exemple, "Ende Gelände" réunit chaque année le temps d'un week-end des milliers d'activistes venus d'Europe pour bloquer une mine de charbon. En 2018, la naissance du mouvement Extinction Rebellion en Angleterre fait des émules. "La semaine de la rébellion" entraîne des blocages dans le monde entier. En France, les "rebelles" interpellent les Français sur le climat, via des blocages pacifiques et spectaculaires d'un pont ou d'un centre commercial.
La désobéissance civile pour la justice sociale et climatique se structure aussi en France autour du mouvement de citoyens ANV-COP 21, Action non-violente COP21, avec des actions coup de poing contre Société générale et ses financements qualifiés de climaticides ou Total. L'une de leurs actions les plus retentissantes est le décrochage de portrait d'Emmanuel Macron dans les mairies, depuis 2019, pour protester contre la politique climatique du président et du gouvernement. Certains prévenus ont été relaxés au nom de "la liberté d'expression", quand d'autres ont écopé d'amendes pour vol. La Cour de cassation, amenée à statuer afin de savoir s'il s'agit de vol ou de liberté d'expression, a rendu son jugement le 22 septembre dernier. "Décrocher un portrait d’Emmanuel Macron pour dénoncer l’inaction climatique peut relever de la liberté d’expression", selon la plus haute instance judiciaire.
Vous avez apprécié cette information ? Abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici !
Pour aller plus loin et agir à votre échelle, découvrez notre guide pratiques "365 jours pour faire sa transition Made in France"
Au sommaire : enjeux, analyses, interview, quiz, conseils et astuces... 68 pages de solutions pour passer au 100% Made in France.
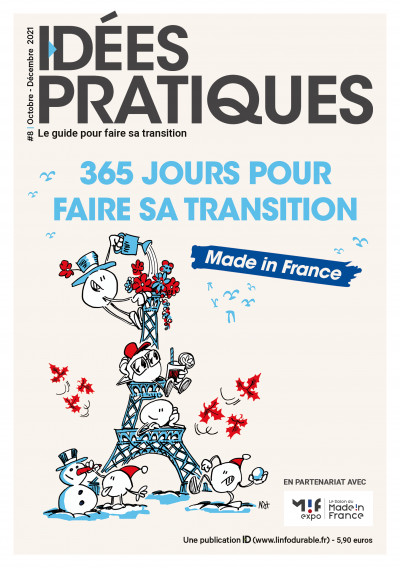
Pour en savoir plus et commander votre guide, c'est par ici.
#TousActeurs