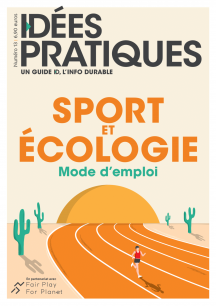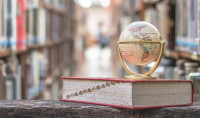La technologie est un outil
Côté bon sens, rien n’a changé. Un outil n’est ni bon, ni mauvais, tout dépend de ce que nous en faisons et de comment nous l’utilisons. Nous savons que chaque outil technologique peut nous apporter le meilleur comme le pire. Une masse dans la main droite de Michel-Ange et un poinçon dans sa main gauche lui ont permis de sculpter le David. Les mêmes outils dans les mains d’un tueur psychopathe donneront un autre résultat. La science nucléaire mène aussi bien à l’électricité nucléaire décarbonée qu’aux déchets nucléaires et à la bombe atomique. Internet sert bien plus à télécharger des contenus pornographiques qu’éducatifs.
Ce qui est nouveau est que nous disposons désormais de plus de recul pour évaluer les effets des usages de la haute technologie. De ce côté, de nouveaux problèmes sont clairement apparus : addiction, « infobésité », pollution numérique, pouvoir de nuisance des écrans sur l’état physique et psychologique, empreinte environnementale des technologies de l’information… il y a donc un sacré revers de la médaille.
Philippe Bihouix est l’auteur de « L’Âge des low tech – vers une civilisation techniquement soutenable » (Seuil, 2014) et de « Le bonheur était pour demain » (Seuil, 2019). il décrit en détail les limites de la pensée techniciste actuelle et les illusions des promesses technologiques. il propose de réfléchir à de nouvelles formes d’innovations.
L’empreinte carbone d’un e-mail varie de 0,3 g équivalent CO2 pour un spam à 50 g équivalent CO2 pour un e-mail avec une pièce jointe, avec une moyenne à 4 g équivalent CO2. Est-ce beaucoup ? En fait, oui, car l’ensemble des services numériques consommait déjà 10% de l’électricité mondiale en 2014 et émet aujourd’hui plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. La fabrication d’un ordinateur de 2 kg nécessite 800 kg de matières premières et émet 124 kg d’équivalent CO2 sur les 169 kg émis sur l’ensemble de son cycle de vie. L’ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par le numérique sont pour 25 % dues aux centres de données, pour 28 % dues aux réseaux (infrastructures avec 45 millions de serveurs, 800 millions de type routeurs, box...) et 47 % dues aux terminaux (9 milliards d’appareils, d’après l’ADEME). Et ceux qui espèrent que l’éco-participation de 5 centimes d’euro qu’ils paient sur le prix de leur smartphone permet de le recycler intégralement sans dumping social ou environnemental, risquent d’être amèrement déçus en suivant les containers pleins de déchets électroniques qui partent en Afrique et en Asie… Bref, les solutions high-tech apportent leur lot de pollutions toujours plus « high » (jusque sur les orbites terrestres où 3 000 épaves de satellites forment la plus « high-tech » des décharges humaines) et augmentent notre dépendance à l’énergie, aux métaux et aux terres rares.
Le préjugé de l’utilité
Mais revenons aux spams ou pourriels, dommage collatéral de l’ère numérique. Je ne sais pas pour vous, mais, de mon côté, je suis toujours plus inondé de spams. Et malgré de nombreuses désinscriptions, pas moyen d’arrêter le flux en collant une étiquette « stop-pub » sur la boîte-aux-lettres ! Me voici condamné à subir cette pollution numérique et psychologique croissante en attendant que mes demandes de désinscription soient respectées et que le principe du pollueur payeur soit appliqué. Mais la high-tech n’est pas seule en cause ici, il s’agit plutôt d’abus commercial boosté par la technologie.
Je prends donc un autre exemple : la voiture autonome devrait générer pour son fonctionnement des dizaines voire des centaines de Megaoctets de données par seconde. Cela ferait 4 000 Go (1 Gigaoctet = 1 milliard d’octets) par jour ! L’ordre de grandeur fait frémir ! Et quid du poids et de la recyclabilité de ce bijou bourré d’électronique et de capteurs… Cela est-il soutenable, donc souhaitable et in fine utile ? L’avenir nous le dira. Enfin, grâce à la mondialisation des systèmes d’information, les populations les plus pauvres ont accès aux images de la vie des ultra-riches entourés d’objets high-tech dernier cri : vecteur d’inclusion ou d’exclusion ?
Sans vraiment le vouloir, nous avons marchandisé notre « temps de cerveau disponible »
Echange part de cerveau contre services gratuits polluants
Ce n’était qu’un clic, juste un petit clic, ce jour où j’ai accepté aveuglément les 15 pages de condition d’utilisation en anglais de cette application. Un petit clic aussi, quand j’ai préféré recevoir des publicités sur mon smartphone plutôt de prendre la version payante. Puis j’ai recommencé encore et encore... Jean Tirole, prix Nobel d’économie, nous avait pourtant mis en garde : « on entend souvent dire que les plateformes devraient payer pour les données que nous leur fournissons. En pratique cependant, certaines le font effectivement, non sous la forme d’un transfert financier mais sous la forme de services non-tarifés ». Les modèles économiques de Facebook et autres GAFAM sont basés sur les recettes publicitaires et notamment sur la publicité ciblée, personnalisée grâce aux données personnelles auxquelles nous leur donnons accès. Sans vraiment le vouloir, nous avons marchandisé notre « temps de cerveau disponible », comme Patrick Le Lay, PDG de TF1, l’expliquait déjà en 2004. C’est le pacte softien, version réelle et contemporaine du fantasmé pacte faustien du XVIe siècle. Finalement, nous acceptons à la fois d’être manipulés et de polluer davantage pour payer moins cher : combien de temps ce paradigme tiendra ?
Qu’est-ce que lA « low-tech » ?
En réaction à cette gabegie, à l’obsolescence programmée et à la pollution silencieuse de la high-tech, la « low-tech » est une notion assez récente qui rassemble l’ensemble des solutions techniques éco-conçues, peu consommatrices de ressources et d’énergie, réparables et/ou recyclables. Mini-ordinateur réparable aux plans disponibles en open-source, voiture légère low-tech increvable, slow food, slow cities, solutions locales testées par le Low-Tech Lab… Les exemples pullulent et beaucoup sont boostés par la démocratisation des technologies de la communication, comme le partage entre voisins, les locations d’outils, la revente d’objets d’occasion, le co-voiturage (avec Blablacar, et même Uber s’y est mis), les vélos partagés, les échanges de logements... En fait, nous sommes déjà entourés de solutions low-tech. Plus inclusives, plus résilientes, elles répondent aux défis de la transition écologique et solidaire et sont par construction plus alignées avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. En bref, elles ont le vent en poupe dans les pays développés et en développement et ce vent n’est pas prêt de s’essouffler.
Que faire aujourd’hui ?
Nous avons mis des décennies à réaliser les dangers pour notre santé et pour les écosystèmes du développement de l’industrie agroalimentaire, de l’agriculture dite conventionnelle et de l’élevage industriel. Dans le monde entier, les industries agroalimentaires ont réussi à faire augmenter le flux de nourriture ingéré par habitant, à grand renfort de publicités, de sucres ajoutés et de « junk food » et in fine ils ont réussi à repousser les limites de nos estomacs et du gaspillage alimentaire. Résultats : il y a plus de personnes en surpoids et d’obèses dans le monde que de personnes sous ou malnutries, et moins de la moitié des aliments produits est finalement ingérée.
La high-tech nous propose notamment de repousser les limites de notre cerveau et de notre existence à coup d’assistance numérique et de réalité augmentée, en attendant la Réul, Réalité Ultime, imaginée par Alain Damasio dans sa dernière dystopie. Beau programme, si nous gardons le contrôle de ce cerveau augmenté et de ces capacités de super-héros, si nous n’y perdons pas notre santé mentale et si nous n’alourdissons pas l’addition pour les écosystèmes. Trois « si » (là encore c’est beaucoup), qui résument les trois principales limites de la high-tech : la liberté, la santé et la planète. Goethe écrivait que « le génie c’est de durer », gardons donc à l’esprit ces trois limites avant d’investir dans la technologie, car beaucoup de solutions high-tech ne dureront pas. Et s’il y a bien un domaine où l’analyse des interactions avec les parties prenantes externes à l’entreprise — le client, la société civile, la chaîne d’approvisionnement, les employés et l’environnement — est riche d’enseignements, c’est bien celui-là.
En conclusion, avec la tech et le big data, il y a à boire et à manger… et à régurgiter aussi. L’investissement responsable y prend une dimension nouvelle, plus que jamais utile et au service d’une performance pérenne.