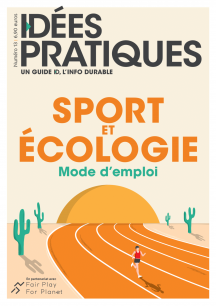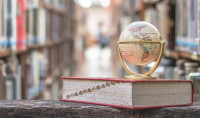Économie vs. écologie, l’équation est sur toutes les lèvres. L’urgence de leur réconciliation impose de reconsidérer une notion fondamentale : la responsabilité. États, entreprises, société civile : jamais leurs rôles n’ont été si vite remis en question. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la Convention citoyenne pour le climat et la "raison d’être" des entreprises abordent toutes, en réalité, un même problème : recalculer le périmètre de responsabilité de chacun. Ce calcul requiert une entente plurilatérale, qui doit trouver ses marques dans un monde fragilisé par la crise.
La responsabilité ne s’arrête pas là où commence celle des autres
À la question "êtes-vous une puissance publique ?", les entreprises sont encore nombreuses à répondre par la négative. A l’heure où les GAFA régissent la machine monde, la notion de responsabilité n’a pas encore fusionné avec celle de gouvernance. Pour autant, peu de politiques publiques se définissent sans concertation préalable avec les parties prenantes. Au seuil de la transition, comment penser les frontières de la responsabilité ? Où se termine la gouvernance du secteur privé, où commence celle du secteur public ?
L’abandon du projet de création d’une agence de notation européenne, le défi de la relocalisation des entreprises, la difficulté de la Commission européenne à arbitrer entre les risques de distorsion de concurrence et les intérêts environnementaux... Autant d’exemples qui illustrent combien l’absence d’un dialogue de qualité entrave la transition écologique et solidaire. Chacun se montre du doigt, défendant son intérêt au détriment d'une vision multilatéraliste. Quelle place pour la "responsabilité" dans cette guerre de territoires ?
Sortir de la crise écologique, économique et culturelle "par le haut" est l’objectif que se sont fixé les acteurs volontaristes, avec comme mot d’ordre le principe universel de "biens communs". Face aux menaces du changement climatique, de l’effondrement de la biodiversité, des crises migratoires et du creusement des inégalités, il est urgent de rendre poreuses les frontières de la responsabilité, pour accélérer la transition, sinon la mener pleinement à bien.

Lost in transitions : faut-il en finir ?
De toutes les contraintes imposées par l’urgence écologique, le temps est la plus importante. Cette course contre la montre doit être inscrite au cœur des stratégies de développement, que cela soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. Ainsi, des objectifs réputés soutenables et réalistes au regard des contraintes émergent à la croisée des positions et intérêts entre les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. Avec par exemple l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050 ou encore la fin des plastiques à usage unique d’ici 2040.
Pour y parvenir, il importe de fixer des paliers, pour prévoir les financements et tenir compte des avancées technologiques. C’est d’ailleurs le sens des myriades de "stratégies nationales" (bas carbone, lutte contre la déforestation importée, etc.) et des pactes d’engagements volontaires des entreprises (Pacte national sur les emballages plastiques, Fashion pact, etc.).
La "transition", qui conserve du latin son sens de "passage", plutôt que de mettre l’accent sur les objectifs, tend à cautionner une véritable culture de l’intermédiaire. Cet espace de flou, où se logent manœuvres correctrices, négociations politiques, diplomatie écologique ou encore retard pris sur des engagements, heurte de plein fouet l’opinion publique. Les citoyens risquent en effet de prendre les discussions intermédiaires pour de l’inaction, et les jalons mis en place, qui plus est lorsqu’ils sont espacés dans le temps, pour son camouflage.
Si dans cette phase transitoire nous nous posions encore la question des objectifs à atteindre, des modèles vers lesquels tendre et à quelle échéance, il est urgent de passer à l’étape suivante. Plus que jamais, passer d’un modèle de transition écologique à celui de transformation écologique impose de réinventer une grammaire commune capable de fédérer là où les acteurs se divisent.
Transition écologique et solidaire : parle-t-on la même langue ?
Pour changer de modèle, ne faudrait-il pas d’abord changer de langage ? Nul doute que les révolutions et les acquis ont d’abord été affaire de sémantique. Dotée d’une raison d’être, l’entreprise sait désormais qu’elle peut dépasser la RSE - Responsabilité sociétale des entreprises -, et se définir en dehors du seul objectif de profitabilité. Les moyens dont l'entreprise dispose désormais lui confèrent une puissance inédite : l'on se rapproche alors des concepts d’utilité publique, voire de missions d'intérêt général qu'on attribuait pourtant plus volontiers au domaine régalien de l'Etat, sans pour autant que l’entreprise n’ait les mêmes échelles de temps ni les mêmes processus démocratiques.
Le changement commence par la création collective d’un nouveau langage précis et crédible. On ne compte plus les nouveaux développements du "parler développement durable" : la raison d’être, la responsabilité sociale et environnementale, l’économie circulaire, le capital naturel, la résilience, l’entreprise contributive. Afin d’éviter de faire du "parler développement durable" un habillage de circonstance et d’être les victimes d’une triple dette climatique, sociale et verbale, il faut au-delà du langage, changer de "récit" et permettre aux acteurs économiques et sociaux de s’y (ré)inventer.
Par Juliette Kirscher-Luciani et Anthony Spitaëls - Institut Open Diplomacy.