Europe-Ecologie Les Verts (EELV) a dévoilé le 30 mai dernier la liste de ses candidats à l’élection sénatoriale de septembre prochain, qui renouvellera la moitié des élus du Palais du Luxembourg. Parmi les candidats, des cadres du parti, comme Yannick Jadot dans la circonscription de Paris, ou Emmanuelle Camelot et Julien Brunel, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui jurent à la presse locale vouloir "dépoussiérer " l’institution. Des candidatures fortes et des promesses de modernité, pour un parti qui dispose aujourd’hui de 12 sénateurs, et espère plusieurs nouveaux sièges en septembre. Pourtant, entre la chambre haute et les écologistes, la relation n’a rien d’une paisible histoire d’amour.
Une hostilité de principe à une chambre conservatrice
Le parti les Verts des années 1990 est d’abord foncièrement hostile au Sénat. "Pendant longtemps, les écologistes considéraient qu’il fallait le faire disparaitre, au profit d’une seule chambre élargie en compétence. Parce qu’on estimait que le Sénat était l’instance de la conservation politique et économique", rappelle Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à AgroParisTech et spécialiste des politiques publiques environnementales. "Quand j’étais jeune maire, même si je n’étais pas Vert, je pensais qu’il fallait supprimer le Sénat. Quand vous êtes dans le camp progressiste, c’est une chambre que l’on juge très conservatrice, qui s’est opposée pendant longtemps à l’avortement, au mariage pour tous…", se rappelle Daniel Breuiller, aujourd’hui sénateur EELV du Val-de-Marne, et possible candidat à sa réélection en septembre.
Depuis sa création en 1958, le Sénat a en effet toujours été dominé par les partis de droite, à l’exception de trois années de majorité socialiste, entre 2011 et 2014. Représentant les territoires, ses membres sont élus par un cortège de grands électeurs, les élus locaux. Une configuration qui privilégie une vision "patrimoniale" de l’environnement, selon Bruno Villalba : "une écologie schématiquement ‘de droite’ aura tendance à considérer que cela ne concerne que quelques domaines d’activité des politiques publiques : préservation des forêts, qualité de l’eau… mais ça ne recompose pas l’ensemble des priorités économiques, comme le projet écologiste porté par EELV, entre autres. […] Les sénateurs ont porté le discours que les chasseurs étaient des experts de la nature. C’est cette idée de conserver quelque chose de traditionnel, dans l’idée des territoires ruraux et leurs pratiques sociales, en y intégrant des préoccupations environnementales", explique le politologue.
Quand on vous écoute, quelques fois on vote les trucs, parce que ça semble logique, pertinent… quand il n’y a pas un grand lobby en face. Sinon, c’est difficile de porter des choses" - Marie-Christine Blandin, sénatrice écologiste de 2000 à 2017
Qu’est-ce qui a changé pour que les écologistes acceptent de rentrer dans une institution si critiquable à leurs yeux ? "En se faisant élire, ils modifient leur discours. Parce que les conditions de travail sont géniales, il y a beaucoup de moyens, comparé à l’Assemblée Nationale. Et puis il y a un enjeu de visibilité du discours. En étant dans les deux chambres, on peut plus peser sur la loi", continue Bruno Villalba. Une inflexion éprouvée au contact de l’institution par Daniel Breuiller : "Elle a aussi un rôle très positif. D’abord c’est la chambre des territoires, dans notre pays où existe une tentation jacobine. Et elle a un deuxième avantage, qui est de ne pas légiférer sous le coup de l’émotion, d’être dans le temps long. Je ne sais pas si le Sénat est indispensable, mais le bicamérisme l’est".
"Obligés de manger de l’écologie"
En octobre 2000, par un jeu d’alliance avec le parti socialiste, Marie-Christine Blandin, alors présidente de la région Nord–Pas-de-Calais, devient sénatrice. "Quand j’arrive là-dedans, ça faisait un petit peu de bruit. Il y avait de grands portoirs avec toute la presse régionale. Comme c’était original qu’il y ait là une écolo, je voyais ma tête partout, c’était bizarre", se rappelle-t-elle. Seule élue écologiste, elle siège avec le groupe socialiste, en y étant "rattachée administrative". Une subtilité procédurière qui lui permet de disposer d’une "totale liberté de parole et de fait". "Mais pour être indépendant il faut pouvoir agir, et seule, on n’a pas tellement d’espace", continue-t-elle.
En 2004, quatre écologistes se rattachent de la même façon au groupe PS. Puis, à partir de 2011, le seuil des dix élus, nécessaire pour créer un groupe parlementaire, est franchi. "Quand on est un groupe, chaque semaine on peut poser une question d’actualité, on a des places réservées dans les commissions d’enquête, on peut être rapporteur d’une mission d’information", explique Marie-Christine Blandin.
Au fil des années, l’ancienne présidente de région accumule responsabilités et victoires législatives. Amiante dans les établissements scolaires, limitation des polluants domestiques, interdiction d’OGM, recyclage des composants de téléphones, et surtout présidence de la commission de la culture, de l’éducation et de la recherche. À plusieurs, les écologistes impriment leurs messages. "L’écologie était omniprésente dans nos prises de parole, et comme elles étaient fréquentes, ils étaient obligés d’en manger", se souvient Marie-Christine Blandin, à l’époque du Grenelle de l’environnement, dont elle fut nommée co-présidente par le ministre de l’Écologie Jean-Louis Borloo.
Les codes de l’institution
Pour investir pleinement l’hémicycle, les écologistes peuvent compter sur des élus "notables", respectés et reconnus par leurs pairs. "L’avantage c’est que j’avais été présidente de région avant. Le Sénat c’est quand même un machin de notables, très feutré, très civil, moi j’avais fréquenté Raffarin, Mauroy, avant. Le fait qu’ils me serrent la main et me disent bonjour, ça évite les quolibets de leurs collègues. C’est plutôt ‘ah bon, elle fait partie des notables ?’". Pour Bruno Villalba, "à partir du moment où il y a eu l’entrée de certains écolos, et pas des moindres, qui avaient l’habitude de la gestion des négociations, comme Marie-Christine Blandin, ça a eu un effet d’élargissement de la réflexion sur l’environnement". En intégrant les codes de l’institution, c’est-à-dire la culture du consensus, de la négociation, les élus verts obtiennent des avancées concrètes.
J’entends souvent parler au Sénat d’écologie punitive. Ce qui est punitif, c’est l’absence d’écologie !" — Daniel Breuiller, sénateur EELV du Val-de-Marne
Une dynamique encore plus favorable aujourd’hui pour EELV, qui dispose d'une nouvelle génération de militants, cadres et experts de la politique. "Les écologistes, comme toutes les forces politiques, ont connu un processus de professionnalisation. On n’avait pas à l’époque [de Marie-Christine Blandin] ces compétences pour composer et gérer des équipes, des partenariats avec le privé… Ça change la donne aujourd’hui, d’avoir des militants qui ont une grande culture technocratique. Dans les associations, les administrations, tout le monde est plus sensibilisé aux sujets écolos. Dans tous les Sciences Po, il y a maintenant des formations à l’écologie ou au développement durable", analyse Bruno Villalba.
Une résistance à la transition
Un constat pas vraiment partagé par Daniel Breuiller. Au départ suppléant de Sophie Taillé-Polian, élue Génération.s, il devient sénateur en juillet 2022 à la surprise générale, la titulaire s'en allant pour l'Assemblée Nationale. En prenant sa place, l’ancien maire EELV d’Arcueil et vice-président de la Métropole du Grand Paris ne cache pas sa surprise : "la première leçon que je tire c’est que le Sénat est une terre très aride à l’écologie. J’ai, dans ma vie institutionnelle, souvent travaillé avec des collègues de toutes les familles politiques, mais c’est au Sénat que j’ai perçu le plus de résistance à la transition écologique, un confort de ne pas envisager de solutions inconnues".
Pour lui, la principale limite à l’avancée de l’écologie politique au Palais du Luxembourg est "l’ignorance des enjeux". "Que des élus ne mesurent pas que l’aggravation de la crise climatique appelle des réponses nouvelles, au lieu de maintenir le dispositif tel qu’il est aujourd’hui, qui est une impasse… c’est être coupable au fond", charge l’élu du Val-de-Marne.
Vingt ans plus tôt, Marie-Christine Blandin faisait le même constat. La nordiste y répond alors par un travail ininterrompu d’éducation : "J’ai une fois fait auditionner le directeur du muséum d’histoire naturelle, sur la biodiversité, illustre-t-elle. Pour les cinquante élus de ma commission, c’était une fenêtre ouverte, ils découvraient que ça faisait partie des choses, que c’était très important. J’insiste beaucoup sur la notion de cultiver d’abord pour que les gens votent ensuite. Si vous arrivez avec toute votre culture et que vous vous contentez de déposer un amendement, ça ne passe pas, il faut d’abord convaincre. Il faut le temps, ça murit".
L'écologie est une pensée de la négociation. Les rapports politiques ouverts ne peuvent pas aboutir à une modification significative des comportements politiques et individuels. Il faut convaincre, éduquer, négocier" - Bruno Villalba, politologue
Interrogé sur de telles évolutions, Bruno Villalba se montre prudent, mais optimiste : "Je pense que le souci du climat, l’accélération des preuves, peut amener à un infléchissement des sénateurs dans le camp majoritaire". Un contexte qui pourrait ouvrir un espace aux écologistes ? "Pas sûr, parce qu’il y a toujours des logiques d’institutions. Par contre il y aura peut-être une acculturation plus grande des sénateurs qui vont arriver à ces enjeux environnementaux".
"On se heurte à un mur"
Reste une limite majeure au développement des thèmes écologistes dans les travées du Sénat. Un bruit qui court plus vite que celui de la crise climatique, et de l’urgence des mesures à prendre : "je pense qu’il y a un poids d’un certain nombre de lobbies ou de grandes institutions", commence Daniel Breuiller. Marie-Christine Blandin raconte un épisode particulier, survenu en 2012. Voulant ouvrir une enquête sur l’ANSES, l’autorité nationale pour la sécurité environnementale et sanitaire, dans le cadre d’un rapport sur les pesticides, sa demande sera rejetée au vote par les sénateurs. "Parce que les lobbies étaient intervenus, estime-t-elle. Ils avaient prévenu l’ANSES, qui est allée trouver le Président de la commission des affaires économiques, pour convaincre tout le monde de ne pas ouvrir l’enquête". Une histoire qu’elle avait déjà racontée à l’époque dans une tribune à Mediapart.
"Le Sénat est le porte-voix de la FNSEA [syndicat majoritaire des exploitants agricoles]. Dès qu’on voudrait dire autre chose qu’elle, on est coupable soit d’être un doux rêveur soit un éco-terroriste !", corrobore le sénateur en exercice Daniel Breuiller. "La FNSEA, les chasseurs, le nucléaire, c’est pareil. Là on se heurte à un mur, on n’est pas à armes égales. On a l’impression que la démocratie représentative est court circuitée par des mécanismes financiers plus puissants, qui se déroulent dans les couloirs des ministères" lâche enfin Marie-Christine Blandin, jusque-là très optimiste sur le pouvoir d’agir des écologistes.
Vous avez apprécié cette information ? Abonnez-vous à notre newsletter en cliquant ici !
Pour aller plus loin et agir à votre échelle, découvrez notre guide Idées Pratiques #12 : "Ecologie : gagner plus, dépenser moins”.
Au sommaire : enjeux, analyses, entretien décryptages... 68 pages pour associer économies avec écologie !

Cliquez ici pour découvrir et commander votre guide Idées Pratiques.
#TousActeurs


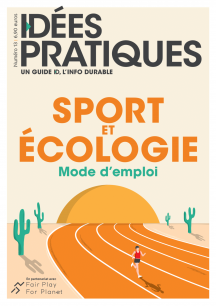


 Article réservé aux abonnés
Article réservé aux abonnés



